| ACCUEIL | ARCHIVES | ABONNEMENT | COURRIER | RECHERCHE |
|
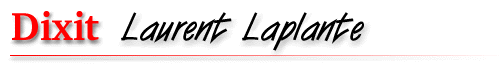 |
|
| ACCUEIL | ARCHIVES | ABONNEMENT | COURRIER | RECHERCHE |
|
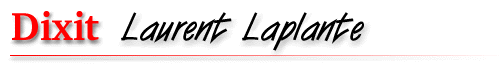 |
|
| Québec, le 1er octobre 2001 Entre l'affaissement et le jovialisme Politique et économie tombent présentement d'accord : quand la confiance populaire se retire, rien ne va plus. Cette confiance, dont on parle d'autant plus qu'elle se fait plus chétive, est ébranlée depuis les attentats du 11 septembre et les chiffres de la bourse poussent autant à la dépression que les affolantes rumeurs répandues presque avec plaisir par la plupart des médias. Heureusement, certains indices, encore peu concluants cependant, permettent d'espérer une embellie. On les trouve, ce qui crée une agréable surprise, dans le monde politique plus que dans l'opinion publique. Comme si le secteur privé n'avait aucune responsabilité. Comme si les citoyens ne voyaient pas encore l'importance de leur propre redressement. Comme s'il n'y avait pas un équilibre à établir entre l'affaissement de le jovialisme. Un geste du premier ministre Chrétien a eu valeur de rappel. En apprenant que le Musée des civilisations venait de retarder la présentation d'une exposition d'inspiration arabe, M. Chrétien, tout en s'inclinant devant une décision qu'il ne pouvait renverser de façon péremptoire, a publiquement exprimé son désaccord : pourquoi ce délai? Pourquoi cette démission? Comme s'ils saisissaient d'instinct la portée du blâme, les différents groupes de parlementaires ont aussitôt emboîté le pas : surseoir à une telle exposition, c'était priver une communauté culturelle d'un droit permanent et stable à l'expression. Beau réflexe de M. Chrétien. Louable unanimité des parlementaires fédéraux sur l'essentiel. De son côté, le gouvernement québécois, qui ne semble pas savoir ce qu'est la définition technique d'une récession, en sait au moins assez long sur les principes de Maynard Keynes pour mobiliser les investissements publics en période de ralentissement économique. Qu'il s'agisse de devancer les échéanciers de certains projets hydro-électriques ou de geler les frais d'immatriculation, le gouvernement Landry accorde ainsi, d'heureuse façon, la priorité aux besoins de l'heure, c'est-à-dire l'emploi et la préservation du pouvoir d'achat, plutôt qu'aux attraits du déficit zéro. Comme il doit le faire, l'État prend la relève d'un secteur privé qui, lui, n'a pas encore commencé à digérer ses traumatismes. Car le secteur privé, dont les hésitations avaient pourtant devancé les attentats du 11 septembre, n'en finit plus d'étaler ses malheurs, d'en noircir la description et de mendier les soutiens gouvernementaux. On n'entend plus, ces jours-ci, de plaidoyers contre le vilain État; on cherche plutôt à se concilier ses faveurs. Ce ne sont pourtant pas les comportements de l'État, mais ceux des conglomérats eux-mêmes qui ont précipité le ralentissement que les attentats ont ensuite occulté. En multipliant les fusions colossales, en les payant infiniment trop cher, en obtenant des banques des financements onéreux à l'extrême, le monde des affaires a voulu profiter d'une période d'euphorie pour rendre irréversible sa vision de la globalisation. Il avait raté l'AMI, il allait se reprendre. Il a réduit la concurrence, mais en promettant aux actionnaires des dividendes gonflés et aux banques des remboursements rapides. Quand les inévitables saturations du marché se sont dessinées, les ventes ont cessé de correspondre aux attentes et les remboursements ont amputé massivement les revenus des parvenus de la spéculation. On avait si bien rationalisé , si cruellement sabré dans la sécurité d'emploi qu'on avait inhibé la consommation. Comme d'habitude, on a recouru à d'autres mises à pied pour réduire les dépenses. C'était faire payer à la main-d'oeuvre la mégalomanie à laquelle on avait succombé lors des acquisitions et des expansions. Il se pourrait maintenant qu'on reproduise encore un paradoxe en forme de scandale : les banques pourraient afficher des bénéfices plantureux, alors même que stagnerait l'économie. Une compagnie d'aviation qui manque de voyageurs n'est pas pour autant exemptée d'honorer le prêt-bail de ses avions et les banques peuvent s'en tirer mieux que leurs clients imprudents. Pendant ce temps, l'opinion publique baigne dans la morosité. Pire encore, les citoyens se déclarent à jamais marqués par les attentats et prêts à échanger une part de leur liberté de mouvement et de leur autonomie politique pour se soustraire à de nouvelles frappes. Alors que l'opinion dépasse en versatilité la plus docile girouette, on prétend marquer d'une pierre blanche le jour où l'on a renoncé à effectuer des voyages au-delà du prochain centre commercial et où l'on a aligné sa capacité d'accueil sur les méfiances et le protectionnisme idéologique du voisin. Cela va changer, mais on jure ses grands dieux que cela ne changera pas. Non seulement cela va changer et le calme régner de nouveau, mais il faut qu'il en aille ainsi. Encaisser un avertissement, ce n'est pas perdre tout droit à la liberté de ses orientations. N'est-il pas infiniment plus sain de croire que la vie peut et doit reprendre ses droits, que l'hécatombe vécue à New York et à Washington plaide en faveur d'une plus grande solidarité avec les peuples démunis et non pas d'un durcissement des contrôles et des suspicions, que la substitution du bas de laine à l'investissement et au partage appauvrirait tout le monde et donnerait raison aux violents? Mais ce redressement exige un sens démocratique, une adhésion personnelle à des valeurs fondamentales, une citoyenneté voulue par chacun. Il ne s'agit pas de passer sans transition de l'affaissement au jovialisme et d'imaginer le 11 septembre autrement qu'il a été. Le drame a eu lieu et il faut en garder mémoire, mais mémoire ne signifie pas paralysie, ni abdication, ni décrochage. Mémoire ne signifie pas non plus qu'on multiplie sans fin et sans la moindre émotion les pleurs rentables en les maquillant en sympathie pour les victimes. Il s'agit, courageusement, de renouer avec la vie et de ne modifier que les attitudes qui expliquent, au moins en partie, cet assaut contre les symboles du capitalisme sauvage et de l'impérialisme béat. La solution ne consiste pas à engouffrer des milliards dans des dépenses militaires parfaitement stériles et même provocatrices, mais à réduire la volatilité des capitaux errants et la gourmandise des grands prédateurs qui pillent le tiers monde pour payer leurs dernières acquisitions. La solution, ce n'est pas de nous blinder contre les risques et de nous enfermer derrière une clôture electrifiée et couronnée de tessons de bouteilles, mais d'amenuiser ces risques. Il y a deux mois, le président Bush vantait les mérites de son bouclier antimissiles et il avait visiblement tort; quand il prétend mener contre le terrorisme une guerre économique de format planétaire sans pourtant encadrer de façon civilisée l'effervescence de la spéculation, il nous trompe tout autant. L'affaissement constitue une renonciation à nos valeurs; le jovialisme qui conduirait à mettre au pas certains adeptes du nivellement économique, mais pas ceux qui dominent la planète, ce serait perpétuer les injustices qui fournissent ses prétextes et parfois ses vrais motifs à l'horreur. Quelque part entre l'affaissement qu'on nous a fait vivre et le jovialisme qu'on nous suggère pour y mettre fin, il y a place pour un redressement de la dignité et une expansion de la solidarité. Certains gestes politiques vont dans le bon sens. Que les citoyens fassent maintenant leur part et les grands prédateurs commenceront peut-être à doser leur démesure. |
Imprimer ce texte ACCUEIL | ARCHIVES | ABONNEMENT | COURRIER | RECHERCHE |
© Laurent Laplante et les Éditions Cybérie |